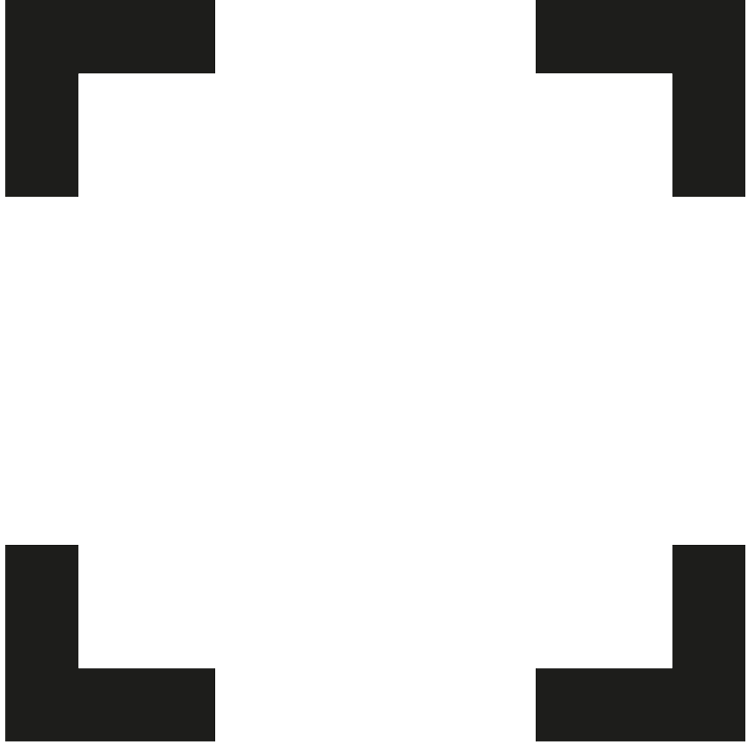Mon nom est personne

Drôle de monde où n’être personne devient un gage de célébrité, où la banalité et la vulgarité gagnent chaque jour un peu plus de terrain pour devenir facteur de succès. Celui qui se réveille le matin en étant satisfait de lui fait sa loi, celui qui doute se fait éjecter. L’architecture n’échappe pas à cette normalité. Le projet qui plaît est le projet qui sera perçu comme normal. Le maître d’ouvrage ne pouvant pas utiliser cet épithète dira « c’est un projet sympa. »
Il faut se méfier comme de la teigne de celui qui qualifie votre projet de sympa. L’architecture est une création et la création n’a rien à faire avec la norme. L’architecture ne peut être normale. Pourtant, le projet qui émergera sera celui qui aura bénéficié du meilleur réseau. Les grosses agences se parent de dircom’ – comme communication ou commerciale – acoquinés aux majors du BTP. Ils s’entendent avant, pendant et après et ont pleins d’amis « proches » parmi les maires qui changent les PLU aussi vite que nous de culottes.
_C’est les affaires coco, on n’est pas là pour faire du sens mais pour prendre de la caillasse.
_T’as lu le dernier livre de Jim Harrisson ? _C’est qui lui ? Un héros de Marc Lévy ?
Quant aux petites agences elles crèvent à petit feu ou se tuent à la tâche pour refaire les baraques de clients privés. Les agences moyennes résistent encore un peu, insistent, persévèrent, tiennent comme elles le peuvent pour offrir, offrir coûte que coûte. Inutile de décrire plus avant la situation que tout le monde connaît.
Pour elles, mais pas pour les autres, oui, l’Architecture est un combat ! Un combat contre le réel, pas celui des suites dans les hôtels de luxe, les salons mondains ou les conférences payantes où l’on peut cabotiner à l’envie ; le réel c’est ce qui cogne !
Alors, on se retrouve dans une situation particulière.
Le choix doit se faire entre une architecture académique, c’est-à-dire un objet répondant en tout point au programme qui lui est demandé. Un objet fignolé et fini, aussi élégant que possible, s’il ne l’est pas ça n’est pas si grave. Il faut surtout qu’il amène des réponses, des réponses définitives et qu’il flatte son commanditaire.
Toutes les starchitectes qui n’en finissent pas d’être jeunes participent de cette lecture mortifère de l’architecture.
Mortifère car l’objet est mort-né, cadenassé dans ses limites, sa seule et unique façon de durer sera dans le budget « maintenance » qui lui sera attribué. Une sorte de budget « chirurgie esthétique » permanent, pas le temps de prendre le temps, pas de temps à perdre, encore moins à donner.
Plus personne n’a de travail pourtant, depuis l’avènement du portable, personne n’a le temps de répondre. Grotesque.
Ces bâtiments finissent par être ridicules, cherchant à s’accrocher à un temps qui n’est plus le leur. Ils sont boursoufflés de Botox et de fatuité. Respectueux de l’ordre. Ce sont des monuments.
La commande cherche à tout monumentaliser pour figer l’objet dans une image crispée qui trahie sa trouille du temps qui passe, sa trouille de l’avenir, sa trouille de tout et son manque hurlant d’imagination.
Cette monumentalisation de l’architecture escamote le processus. Et ça n’est pourtant que le processus qui fabrique de la ville et de la vie, pas l’étiquette « auteur » que l’on colle sur n’importe quelle façade pour la cataloguer et la ranger dans la grande bibliothèque Billy des projets urbains.

Pourtant une autre tendance peut émerger, peut-être. Elle doit émerger si elle trouve un écho. Elle est plus ouverte, moins sûre d’elle. C’est une démarche qui consiste à ne pas être seulement dans la fabrication d’un objet mais aussi dans une façon de projeter le monde, de l’interroger, de l’appréhender pour y trouver sa place.
Arrêter d’être raisonnable, et timoré, arrêter d’enfoncer des portes ouvertes à grands coups de testostérone. Faire marcher ses neurones pour l’autre autant que pour soi, écouter son intuition et respecter le sensible.
La raison ne devrait que suivre l’intuition. La raison sépare et isole tandis que l’intuition unifie et harmonise.
Ce monde ne sait plus voir les choses sensibles, filtrant tout par son prisme scientifique et technique. La place du sensible a été presque totalement détruite par les programmes préalablement établis rigides et froids où tout est prévu, où la prise de risque réside dans le choix du garde-corps ; où il faut choisir le projet en fonction de tous les aspects sécuritaires qu’il véhicule. La place du mystère, de l’aventure, de la découverte est éradiquée ou presque. Tout doit être explicable, rationalisé, plus aucune place n’est faite à une forme quelconque de spiritualité non religieuse évidemment.
Il faut se laisser aller à croire, à croire que les choses sont possibles.
Pourtant, celui qui est devant quelque-chose ou quelqu’un et qui ressent profondément une émotion en se disant : « c’est beau » par exemple, saurait-il expliquer pourquoi ?
Saurait-il dire pourquoi les poils se dressent sur son bras au son de cette musique-là ? Vouloir toujours expliquer l’architecture, c’est vouloir lui enlever toute sa capacité d’émotion.
Les bâtiments réputés sont le plus souvent des bâtiments qui se regardent, ils sont beaux de dehors parce qu’ils sont fermés, étanches, ils enferment la lumière et l’individu n’en est que le spectateur. Pourquoi sont-ils si fermés ?
Et si tout le pognon allait ailleurs que dans la façade ?
Et si on les ouvrait ces bâtiments, histoire de leur donner un peu d’air, histoire de les laisser devenir ce qu’ils sont et pas ce que l’on veut qu’ils soient.
Il y a un moyen pour cela, un moyen très simple, arrêter de prendre l’individu, l’usager comme un simple spectateur mais comme un acteur, un acteur à part entière du projet qui se fait avec lui.
Le jour où on livre le bâtiment il n’est pas fini, il commence sa vie simplement. Plus avec l’architecte mais avec l’architecture. Plus d’auteur mais des acteurs.
Il faut traquer le beau, il faut traquer la beauté comme une sorte de revanche sur la raison.
Il faut que l’architecte se revendique dérangeur, séducteur, enchanteur de la rue. Trouver partout le moyen de repousser les limites, de les faire comprendre, à défaut de les faire accepter. C’est la seule manière de susciter l’imaginaire et la volonté de voir autrement, de voir autre chose. C’est la seule manière de revaloriser l’individu au sein de l’objet. C’est la seule manière de proposer des pistes sur lesquelles la liberté peut s’élancer.
Il faut arriver à la simplicité ; malgré soi en s’approchant du sens réel des choses.
Il faut se redonner du temps, répondre au téléphone, être attentif à l’autre, savoir regarder ; il faut ré-apprendre à espérer ou plutôt à ne plus rien espérer, l’espoir n’existe pas. Il faut croire en ce qui est et à rêver pour que ce monde recommence un peu à s’aimer.
L’expérimentation se fera par l’exemple, l’enfant sage aura encore la bonne note de cul béni de premier de la classe, il gagnera les concours ou les offres gratuites sans projet où il aura pourtant dessiné jusqu’à la poignée, tandis que le trublion les perdra encore et encore jusqu’à ce qu’il en chope un, et lui un autre et que peu à peu les lignes bougent et les règles varient. Il en va de la survie de l’architecture. Soit on continue à faire des tombeaux où l’«auteur » architecte sera bientôt salarié d’Eiffage ou de Bouygues. Soit on fait de l’intelligence et de l’imagination le roi et la reine de ce nouvel échiquier.
Pour l’instant ils ne nous entendent pas. C’est parce qu’on crie trop fort. Chuchotons leur à l’oreille alors que l’avenir n’est pas quelque chose qui se subit, il se surmonte, et il se fait là, au présent.
Matthieu Poitevin
Terence Hill dans le film « Mon nom est personne » de Tonino Valerii, 1973. © DR / Image choisie par l’auteur.